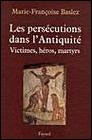 | |
Tolérance et intolérance dans l’Antiquité | | | Marie-Françoise Baslez Les Persécutions dans l'Antiquité - Victimes, héros, martyres
Fayard 2007 / 24 € - 157.2 ffr. / 417 pages
ISBN : 2-213-63212-X
FORMAT : 15,0cm x 23,5cm
L'auteur du compte rendu : Yann Le Bohec enseigne lhistoire romaine à luniversité Paris IV-Sorbonne. Il est lauteur de plusieurs ouvrages destinés tant aux érudits quau grand public, notamment LArmée romaine sous le Haut-Empire (Picard, 3e édit., 2002), César, chef de guerre (Éditions du Rocher, 2001) et Histoire de lAfrique romaine (Picard, 2005) ; une Armée romaine sous le Bas-Empire est sortie à lautomne 2006 (Picard).
Imprimer
Louvrage de M.-F. Baslez poursuit une série de travaux très anciennement inaugurée et, dans le même temps, il sinscrit dans une problématique toujours à la mode. En effet il renvoie dun côté à La Persécution du christianisme de J. Moreau (1956) et de lautre à une multitude douvrages consacrés au même sujet ; parmi les plus récents nous citerons Dying for God de D. Boyarin (1999) ou encore Making Martyrs de L. Grig (2004). Mais M.-F. Baslez part dune idée originale : les Chrétiens nont pas été les seules victimes de persécutions. Certes, les Juifs ont depuis longtemps attiré lattention sur le traitement qui leur avait été réservé par Rome à certains moments de leur histoire. Mais personne navait eu lidée de regrouper Juifs et Chrétiens dans ce même camp de souffrances et, plus encore, de leur ajouter des polythéistes. De là une conclusion originale : les persécutions ne visaient pas le monothéisme en tant que tel ; elles étaient dirigées contre des individus ou des groupes qui se mettaient en dehors des structures collectives sociopolitiques.
De fait, dans une première partie, qui sont les martyrs ?, on voit que des personnages aussi célèbres que le poète Eschyle ou lhétaïre Aspasie furent poursuivis. Le plus célèbre de ces persécutés reste néanmoins Socrate, symbole pour léternité du juste martyrisé : «Socrate, disait lacte daccusation, est coupable de corrompre la jeunesse, de ne pas honorer les dieux quhonore la cité, mais dautres divinités nouvelles» (cité p.28). La religion joua néanmoins souvent le rôle de détonateur, si lon peut dire, et les Juifs furent, tout au long de lAntiquité, des victimes, en particulier du roi Séleucide Antiochos IV en Syrie ; on lira, à propos de ces machinations, le Livre des Macchabées. Ils ne furent pas les seuls, au demeurant. En 186 avant J.-C., le culte de Bacchus fut sévèrement réglementé, mais pas interdit, comme nous lapprennent Tite-Live et une inscription, car le Sénat de Rome réprouvait les excès qui laccompagnaient. Sous lempire romain, quelques intellectuels, surtout des stoïciens, durent souffrir pour leurs idées ; et M.-F. B. commente les Actes des Alexandrins qui font connaître une partie dentre eux. En revanche, les religions venues dOrient et diffusées en Occident échappèrent aux poursuites car elles représentaient un phénomène «périphérique» (p.89).
La deuxième partie répond notamment à une autre question : comment connaît-on les martyrs ? Si les textes grecs, et romains à leur suite, ont vanté «la belle mort», on remarque que cet aspect laissait indifférents les Juifs qui, bien plus, acceptaient la mort infamante car, pour eux, lessentiel se trouvait ailleurs, dans le passage à une autre vie (p.159) ; comme on sait, ils ont exercé une forte influence sur les Chrétiens. De fait la littérature apocalyptique, née chez les premiers, a également été utilisée par les seconds. Les uns et les autres ont manifesté un certain goût pour la mort, qui a donné naissance au montanisme, une doctrine vite jugée hétérodoxe, qui recommandait aux fidèles de se jeter au-devant du martyre pour rejoindre plus vite le Seigneur Dieu. Luvre de Tertullien a illustré cette thèse (mais on ignore si lécrivain lui-même a fini de la sorte, sil a suivi ses propres conseils).
La troisième partie montre comment la société romaine et, à sa suite, lÉtat, sont passés de la condamnation sociopolitique à la condamnation religieuse. Au départ, ce sont «les auteurs du Nouveau Testament (qui) ont véritablement inventé le concept de persécution» (p.263). Et, sous lEmpire, les Juifs et les Chrétiens servaient de boucs émissaires parfaits pour détourner les agitations populaires diverses. M.-F. B. pose alors le problème toujours aigu des fondements juridiques des persécutions. Elle montre comment les causes ont évolué, surtout à cause du changement du IIIe siècle. La crise qui marqua cette époque, dabord militaire, et ensuite économique, sociale, morale, bouleversa les habitants de lempire et le conflit devint religieux, entre les tenants de lempereur-dieu et ceux du Christ-roi. Les polythéistes trouvèrent des boucs émissaires, précisément, dans les Chrétiens. La grande persécution, qui sacheva en 304, provoqua un «engrenage de lintolérance» (p.363). Quand les Chrétiens furent au pouvoir, par lintermédiaire de Constantin Ier, quils appellent souvent «le Grand», ils se firent à leur tour persécuteurs.
M.-F. B. arrête sa chronologie à lannée 336, sur un texte de la législation impériale qui punit des hérétiques. Elle aurait pu relever un changement dans la continuité. Cest que les Chrétiens, de persécutés, se firent persécuteurs. Les Juifs, victimes de lempire polythéiste, furent aussi victimes de lempire chrétien. Les polythéistes eux-mêmes, traités de «paysans» (cest ce que signifie le mot «païens») furent eux aussi et à leur tour victimes de persécutions. Une longue série de textes législatifs priva les temples de leurs biens et interdit aux fidèles de pratiquer leur religion. Plus souples que les Chrétiens, ces derniers sexposèrent rarement à la peine de mort et le meurtre de la philosophe païenne Hypatie nest quun cas particulier qui ne sexplique pas seulement par des raisons religieuses. Et les hérétiques ou schismatiques furent parfois encore plus durement châtiés ; en témoigneraient les donatistes africains contre qui fut envoyée la troupe. On remarque dailleurs que la législation (contre les hérétiques, les Juifs et les païens) reprend avec fidélité lapologétique, cet ensemble décrits des Pères de lÉglise qui, précisément, visaient ces trois catégories.
Ce livre mérite dêtre lu lentement, avec une plume à la main ; il faut noter toutes les questions quil pose
et toutes les réponses quil leur apporte. Lidée de départ sest révélée féconde et elle a permis daboutir à des conclusions, partielles ou générales, tout à fait séduisantes. Comme le texte est bien écrit, le lecteur joindra lutile à lagréable.
Yann Le Bohec
( Mis en ligne le 13/02/2007 )
Imprimer | | |