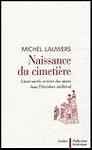 | |
Quand les morts voisinaient avec les vivants | | | Michel Lauwers Naissance du cimetière - Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval
Aubier - Historique 2005 / 24 € - 157.2 ffr. / 394 pages
ISBN : 2-7007-2251-5
FORMAT : 13,5x22 cm
Lauteur du compte rendu : agrégée dhistoire et docteur en histoire médiévale (thèse sur La tradition manuscrite de la lettre du Prêtre Jean, XIIe-XVIe siècle), Marie-Paule Caire-Jabinet est professeur de Première Supérieure au lycée Lakanal de Sceaux. Elle a notamment publié LHistoire en France du Moyen Age à nos jours. Introduction à lhistoriographie (Flammarion, 2002).
Imprimer
Dans la très belle collection "Historique", chez Aubier, dirigée par Alain Corbin et Jean-Claude Schmitt, Michel Lauwers, professeur à luniversité de Nice, sinterroge sur la Naissance du cimetière. Il sagit dun ouvrage universitaire, donc accompagné dun abondant appareil critique : notes, bibliographie et index.
Lauteur, dans ses remerciements, précise bien sa filiation intellectuelle : Jacques le Goff et Alain Guerreau en particulier. Cest dailleurs à la suite dune observation de ce dernier sur «le silence des textes médiévaux sur les espaces-objets qui avaient précisément pour fonction de structurer lespace social : les églises, les reliques, les cimetières. Ces objets «allaient de soi», poursuit-il, pour ainsi dire, et nont donné lieu, sauf exceptions rarissimes, à aucun développement abstrait. On trouve ici une sorte de «trou noir» de la pensée médiévale, qui devrait faire lobjet de recherches et de réfléxions approfondies» (cit.p17). Pour y répondre, M. Lauwers a sollicité les sources archéologiques, les théologiens mais aussi les juristes, et a constitué un vaste corpus de textes souvent cités, à lappui de sa démonstration.
Une demande de Dominique Iogna-Prat dorganiser dans le cadre dun colloque sur la spatialisation du sacré, une table ronde sur lespace des morts, la conduit à ces recherches sur la naissance du cimetière. Que louvrage ait été édité dans la collection dirigée par Jean Claude Schmitt na rien que de très logique, puisque, nous avertit M Lauwers, «cest donc à une sorte danthropologie du sacré appliquée à lOccident médiéval que jinvite le lecteur» (p.17).
La question qui se pose est de définir le cimetière comme un objet dhistoire et de suivre lévolution de son statut des VIIe-XIIIes. Au cours de cette période, lespace des morts devient progressivement un lieu consacré, au centre de la communauté des vivants, contigu à léglise. Il sagit alors de comprendre comment les clercs saffranchissent de lautorité des seigneurs, font de léglise et du cimetière un espace sacré. Les VIIIe-IXe siècles constituent une étape décisive dans cette évolution qui conduit les évêques carolingiens à organiser lensemble des lieux de culte. Des récits fondateurs témoignent de cette évolution, avant quaux XIIe et XIIIe siècles les juristes de droit canonique la théorisent en même temps que se définit la «paroisse».
Éloigné des vivants durant lAntiquité, le cimetière médiéval est inséré au cur de lespace habité, du moins pour les morts chrétiens, alors quentre les XIe et XIIIe siècles se définissent des espaces funéraires réservés aux communautés juives. Enfin lOccident se préoccupe de la sépulture des exclus, excommuniés et interdits, qui ne peuvent être ensevelis en terre consacrée. À partir du XIIe siècle, les autorités ecclésiastiques en dressent la liste : adultères, excommuniés, suicidés etc. Des champs sont réservés pour les enfants morts sans baptême.
Désormais le séjour des morts devient un «espace social fortement investi», partie dune communauté : léglise, celle des vivants et des morts ancrés dans la même terre, et l'on peut noter alors la polysémie du terme ecclésia qui désigne à la fois le groupe des fidèles, le bâtiment matériel, et éventuellement linstitution et le personnel ecclésiastique. Lexistence de lieux consacrés (églises, cimetières) est dailleurs une des originalités de loccident chrétien.
Cest dans le cadre dun plan classique, en trois parties, que nous suivons la naissance du cimetière : "Des lieux sacrés, saints et religieux" (I), "Terra cimiteriata" (II), "Possession et usages de la terre cimitériale" (III). Dans la première partie, lauteur présente, en sappuyant sur les sources archéologiques, le choix des lieux et la construction progressive dun espace contigu à léglise au coeur de la communauté des vivants. En suivant depuis le haut moyen âge les textes des autorités ecclésiastiques, il montre une évolution qui, des VIe-IXe siècles aux XIIe-XIIIe, conduit à utiliser, tout en sen démarquant, les catégories antiques et à poser trois types de lieux : sacré («dédié à Dieu par la main de lévêque» - p.108), saint («lieu établi pour les serviteurs de léglise» - ibid.) et religieux («tout lieu dans lequel est enterré le corps dun homme ou une tête» - ibid.).
La seconde partie décrit lhistoire de la consécration des cimetières, contigus aux églises ; à lépoque médiévale, les morts sont ensevelis en pleine terre (les sarcophages de lantiquité, remplacés par de simples coffres disparaissent vers le VIIIe siècle), de façon individuelle ; les fosses sont souvent creusées et les ossements déplacés dans des ossuaires. LEglise lutte contre la pratique de sépultures à lintérieur du bâtiment et en contrepartie la sacralisation de lespace cimetieral saccentue. La pratique de la consécration du cimetière apparaît dans lensemble lotharingien, puis dans le monde anglo saxon (XeXIe siècle), et lhabitude dinhumer les morts dans cet espace clos et protégé se généralise en Occident entre les Xe et XIIIe siècles. Généralisation qui ne sopère pas sans conflits (entre autorités seigneuriales et autorités ecclésiastiques, entre évêques et moines, etc.) mais simpose, alors que parallèlement simpose aussi lélaboration de listes dexclus qui ne peuvent prétendre reposer dans un espace funéraire défini comme chrétien.
Enfin la troisième partie analyse les pratiques sociales. Les auteurs du Moyen Age, dans ce domaine, sappuient sur la Genèse (chapitre 23), lépisode du tombeau des Patriarches, qui décrit la façon dont Abraham acheta un champ et une grotte pour y aménager un caveau à son épouse défunte, près dHébron. Le texte fit lobjet de commentaires abondants, et les exégètes chrétiens sattachèrent plus particulièrement à deux points : lidée de tombe familiale (particulièrement appréciée des milieux aristocratiques) et lachat du lieu (peut-on monnayer lemplacement dune sépulture ?). A partir du synode dArras (1025), les questions se déplacent et laccent est porté sur la nécessaire union des chrétiens dans la mort, Abraham devient de façon un peu inattendue linventeur en quelque sorte des cimetières chrétiens des XIe-XIIIe siècles. «Le cimetière, qui jouit des mêmes privilèges que léglise, est consacré et béni, tout comme le Seigneur a béni, par les mains de ses serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, la terre achetée aux fils dHébron pour leur sépulture.» (Guillaume de Mende, mort en 1296, p.220). Il est rassurant dêtre inhumé sous le patronage symbolique du prophète, préfiguration du salut éternel symbolisé couramment par limage du «sein dAbraham» en qui reposent les élus au Paradis.
Séjour des morts, le cimetière ne se résume pas à cette seule fonction, les vivants loccupent aussi : lieu sacré, mais également espace de plaid, lieux des fêtes, des danses, des jeux, des marchés
avec toutes les questions et conflits quentraîne cette imbrication entre sacré et profane. Habité, construit, planté durant plusieurs siècles, le cimetière est lobjet au cours du XIIIe siècle dune réappropriation par les autorités ecclésiastiques. Évolution qui entraîne une réduction de la superficie de la terre des cimetières, ce que confirme larchéologie, et le silence progressif des textes sur cette question, signe de lefficacité des nouvelles dispositions.
Le cimetière prend un sens nouveau : lieu de prières, espace théâtralisé de la peur de lenfer, apprécié des prédicateurs, soucieux dimpressionner leurs ouailles. Ainsi après avoir été durant plusieurs siècles un lieu où les ancêtres participent en quelque sorte de la communauté de vivants, le cimetière devient un espace où ces mêmes vivants contemplent leur destin futur
Inscrit dans tout un courant de réflexion sur la mort et son histoire en Occident depuis P. Ariès, le livre de M. Lauwers répond avec rigueur et clarté à la question initiale : faire du cimetière un objet dhistoire.
Marie-Paule Caire
( Mis en ligne le 17/09/2005 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:D'or et de cendres
de Murielle Gaude-Ferragu La Société du haut Moyen Âge
de Régine Le Jan | | |