|
|
| Histoire & Sciences sociales -> Moyen-Age |
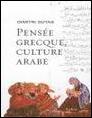 | |
Un mouvement de traduction en phase avec son temps | | | Dimitri Gutas Pensée grecque, culture arabe - Le mouvement de traduction gréco-arabe à Bagdad et la société abbasside primitive (IIe-IVe/VIIIe-Xe siècles)
Aubier 2005 / 28 € - 183.4 ffr. / 340 pages
ISBN : 2-7007-3415-7
FORMAT : 14,0cm x 22,0cm
L'auteur du compte rendu : Sébastien Dalmon, diplômé de lI.E.P. de Toulouse, est titulaire dune maîtrise en histoire ancienne (mémoire sur Les représentations du féminin dans les poèmes dHésiode) et dun DEA de Sciences des Religions à lEcole Pratique des Hautes Etudes (mémoire sur Les Nymphes dans la Périégèse de la Grèce de Pausanias). Ancien élève de lInstitut Régional dAdministration de Bastia, il est actuellement professeur dhistoire-géographie.
Imprimer
Lactualité du Moyen-Orient en général et de lIrak en particulier nous font oublier que cette région du monde fut, sous le pouvoir à peine conquis des Abbassides, entre le VIIIe et le Xe siècle apr. J.-C., le lieu dun formidable éveil de la pensée philosophique et scientifique.
Cet essor de la vie intellectuelle saccompagne dun vaste mouvement de traduction de textes grecs anciens, dont le centre est Bagdad, ville nouvelle et capitale qui succède à la Damas omeyyade. Cest à ce mouvement particulièrement notable dans son ampleur et sa durée quest consacré louvrage de Dimitri Gutas, professeur de langue et littérature arabes à luniversité de Yale. Lédition originale de louvrage aux Etats-Unis date de 1998, mais lauteur a ajouté une préface inédite à la traduction française, rappelant les avancées de la recherche sur le sujet, et égratignant au passage la théorie du choc des civilisations qui postule que celles-ci saffrontent et sont intrinsèquement incompatibles entre elles. Il est pour lui essentiel que nous puissions apprendre de lhistoire que les civilisations peuvent être harmonieuses, interdépendantes et étroitement liées, comme la rencontre diachronique entre la civilisation grecque et la civilisation arabe, lunité de chacune étant essentiellement linguistique et culturelle (certainement pas ethnique).
Après avoir rappelé dans un avant-propos lhistoriographie des études gréco-arabes depuis le XIXe siècle (Göttingen, 1830), Dimitri Gutas envisage le mouvement de traduction gréco-arabe en tant que phénomène social et historique. Lapproche nest donc pas simplement philologique, mais aussi historique, politique et sociale.
Plus dun siècle et demi détudes gréco-arabes ont amplement montré quà partir du milieu du VIIIe siècle environ jusquà la fin du Xe siècle presque tous les ouvrages séculiers grecs à caractère non littéraire et non historique qui étaient disponibles dans lensemble de lEmpire byzantin et le Proche-Orient furent traduits en arabe. Cela concernait les matières du quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, théorie de la musique), la philosophie aristotélicienne (métaphysique, éthique, physique, zoologie, botanique et logique), les sciences relatives à la santé (médecine, pharmacologie, sciences vétérinaires), mais aussi des ouvrages dastrologie, dalchimie et dautres sciences occultes, ainsi que dautres genres décrits plus marginaux (tactique, recueils de sagesse populaire et même fauconnerie). Ce mouvement de traduction a été tel que, de nos jours, létude des écrits séculiers grecs post-classiques peut difficilement se faire sans les textes en arabe. Il représente une performance stupéfiante, qui doit être appréhendée comme un phénomène social (aspect jusquici très peu étudié). Sétalant sur plus de deux cents ans, il ne fut pas un phénomène éphémère. Il sappuya sur lensemble de lélite de la société abbasside, cest-à-dire les califes et les princes, les fonctionnaires civils et les chefs militaires, les marchands et les banquiers, les professeurs et les savants. Il fut subventionné par dénormes fonds, à la fois publics et privés. Enfin, il fut mené selon une méthodologie scientifique rigoureuse et une stricte exactitude philologique, sur la base dun programme soutenu qui couvrit plusieurs générations.
Une telle durée manifeste clairement que le mouvement était en phase avec les besoins et les tendances inhérentes à la société abbasside naissante. Le soutien au mouvement de traduction transcendait toutes les divisions religieuses, ethniques, tribales, linguistiques ou de sectes. Les mécènes se recrutaient aussi bien parmi les Arabes que les non-Arabes (Perses, Kurdes
), les musulmans que les non-musulmans, les sunnites que les chiites, les généraux que les fonctionnaires, les marchands que les propriétaires fonciers, etc
Le mouvement de traduction gréco-arabe est un phénomène social extrêmement complexe dont la cause ne peut être réduite à aucune circonstance singulière, aucune série dévénements, ni aucune personnalité. Un grand nombre de facteurs ont contribué à son développement et à son alimentation.
Dans une première partie, «Traduction et Empire», Dimitri Gutas montre que le mouvement de traduction était fortement lié à la fondation de Bagdad et à létablissement dans cette ville des califes abbassides en tant quadministrateurs dun empire mondial. Malgré une activité de traduction sous les Omeyyades, qui ont repris les cadres administratifs de gestion byzantins, ce sont surtout les Abbassides qui développent un mouvement de traduction dune ampleur inégalée, renouant avec lidéologie impériale zoroastrienne des Sassanides, qui était beaucoup moins hostile que les Byzantins à la science grecque païenne. Cest Al-Mansur, fondateur de Bagdad et second calife abbasside, qui est crédité par les auteurs arabes davoir initié et promu le mouvement de traduction. Lastrologie est vue comme la science maîtresse : par ordre de Dieu, les étoiles auraient décrété que cétait maintenant au tour des Abbassides de renouveler les sciences et de dominer la région, comme cétait celui des Sassanides précédemment. LEtat abbasside affirme ainsi sa légitimité, notamment face aux réactions pro-omeyyades ou revivalistes perses zoroastriennes. Le mouvement est poursuivi par son successeur Al-Mahdî (qui fait notamment traduire les Topiques dAristote afin de disposer dun ouvrage enseignant la dialectique, fort utile pour les disputes théologiques contre les Chrétiens et les représentants des autres religions) et ses fils (Al-Hâdî et Hârûn Al-Rashîd), puis Al-Mamûn (après quil eut éliminé son frère Al-Amîn). Ce dernier sappuie sur le mouvement de traduction pour légitimer son pouvoir (et justifier son régicide qui est aussi un fratricide), se posant comme autorité suprême des Musulmans. Cette promotion rejoint aussi des intérêts de politique étrangère, le philhellénisme se posant, par un paradoxe qui nest quapparent, comme une idéologie anti-byzantine (les Byzantins ayant tourné le dos à la science ancienne à cause du christianisme). Lidéologie musulmane se veut également rationaliste, ce qui la conduit à mettre à lhonneur la philosophie aristotélicienne, et donc à relancer les traductions des textes du fondateur du Lycée.
Dans une deuxième partie, «Traduction et société», Dimitri Gutas montre dabord que la traduction se trouve au service du développement de la science théorique et appliquée, en phase avec la demande dastrologie, les besoins en éducation professionnelle des secrétaires administratifs, juristes ou ingénieurs (comptabilité, géométrie, algèbre, agronomie
) ou les besoins de la recherche scientifique et de la connaissance théorique (en mathématiques, médecine ou philosophie). Ce sont avant tout les califes abbassides, leurs familles et leurs courtisans qui patronnent le mouvement, mais également les fonctionnaires, les militaires, les lettrés et les savants. Les traducteurs du grec et du syriaque appartiennent souvent aux Eglises chrétiennes (melkites, jacobites ou nestoriens), même sil ny a aucune exclusivité. Le développement dune tradition scientifique et philosophique arabe engendre une demande massive de traductions. Celles-ci saméliorent en qualité avec le temps, les traducteurs étant devenus, grâce à la demande croissante, des professionnels. Mais après un vigoureux parcours de plus de deux siècles, le mouvement de traduction à Bagdad se ralentit et arrive finalement à son terme autour de lan mille. Cela ne signifie pas quil y eut une diminution de lactivité scientifique, bien au contraire ; en effet, les ouvrages grecs ont perdu leur actualité scientifique, et la demande se porte désormais sur des uvres originales arabes innovantes (notamment les livres dAvicenne, Al-Khwârizmî ou Al-Fârâbî). Le mouvement de traduction a cependant le temps dinfluencer, à létranger, cet autre renouveau intellectuel quon a appelé le «premier humanisme byzantin» (au IXe siècle).
Le livre de Dimitri Gutas a lavantage de démontrer que le mouvement de traduction gréco-arabe ne peut être compris indépendamment de lhistoire sociale, politique et idéologique des débuts de lempire abbasside. De plus, ce mouvement a préservé pour la postérité, en traduction arabe, des textes grecs perdus, tout en contribuant à la préservation de certaines uvres en grec. Son influence a été déterminante dans le monde byzantin grec, mais aussi dans lOccident latin, que ce soit lors de la renaissance du XIIe siècle ou de la Renaissance proprement dite.
Sébastien Dalmon
( Mis en ligne le 16/11/2005 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:L'Occident médiéval face à l'Islam
de Philippe Sénac Al-Andalus 711-1492
de Pierre Guichard Islam et voyage au Moyen Âge
de Houari Touati | | |
|
|
|
|
|