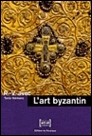 | |
Introduction à l’art byzantin | | | Tania Velmans L'Art byzantin
Rouergue - R.V. avec : 2007 / 18 € - 117.9 ffr. / 69 pages
ISBN : 978-2-84156-840-6
FORMAT : 20,0cm x 29,0cm
Traduction de Fabienne Andréa-Costa.
Lauteur du compte rendu : agrégée dhistoire et docteur en histoire médiévale (thèse sur La tradition manuscrite de la lettre du Prêtre Jean, XIIe-XVIe siècle), Marie-Paule Caire-Jabinet est professeur de Première Supérieure au lycée Lakanal de Sceaux. Elle a notamment publié LHistoire en France du Moyen Age à nos jours. Introduction à lhistoriographie (Flammarion, 2002).
Imprimer
Dans les premiers titres de la collection «Rendez vous avec lart» (à partir de lédition italienne Jaca Book, spa Milan,2007), les éditions du Rouergue proposent un volume sur lart byzantin. Le texte est confié à Tania Velmans, historienne de lart et directrice de recherche au CNRS ; les légendes des illustrations, abondantes (cest le principe de la collection), sont de Fabienne Andre-Costa. Un glossaire et un index sont placés en fin de volume ; des cartes, des dessins et des plans complètent lapproche pédagogique. Une double page centrale (p.39) donne la frise chronologique de la période couverte (IVe-XVIe siècle) et souvre sur la présentation de fresques dans une église byzantine : la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, au monastère de Miroza (Pskov, Russie).
Lauteur rappelle en introduction les étapes de la construction de Byzance, issue de Constantinople fondée par lempereur Constantin (324-330 après JC), et cite lhistorien Georg Ostrogorsky : «Structure romaine de lEtat, culture grecque et foi chrétienne : telles sont les grandes sources doù Byzance est sortie». Le centre de la civilisation byzantine est Constantinople (Istanbul), capitale dun état autonome dès le partage de Théodose (395) : lEmpire dOrient. Son aire dinfluence est vaste et englobe les zones christianisées par Byzance : Slaves du Sud, Roumanie, Russien Cappadoce, Georgie et Arménie, Syrie, Palestine et Egypte (jusquà la conquête arabe et lislamisation au VIIe siècle) ; en Occident les limites extrêmes sarrêtent à la Dalmatie. Cet immense ensemble dont les limites fluctuent au cours des âges, jusquà la prise de Constantinople par les Ottomans (1453), est marqué par une foi chrétienne qui sexprime dans la construction déglises, de monastères, de chapelles richement décorées, et la foi aussi dans un empereur, signe de lunité politique. Pour comprendre lart byzantin, il faut en connaître les grands principes marqués par le christianisme oriental, civilisation ancienne, centre dune culture de très haut niveau théologique.
Le plan de louvrage est clair : Architecture, peinture murale et icône, les arts mineurs. Les églises byzantines se reconnaissent aisément à leur plan rond ou octogonal à coupole, héritières des monuments funéraires romains. Ces églises sont des «martyria», telle la rotonde du Saint Sépulcre à Jérusalem (IVes). Au VIe siècle, les architectes byzantins conçoivent un plan original en articulant la coupole sur le classique plan basilical, rectangulaire, des Romains. Tout lintérieur est décoré de mosaïques à fond dor et de peintures. Ce modèle a été largement imité et adapté au fil des siècles et des zones géographiques, dans le sens dune complication et dune richesse croissantes.
Lart de licône (à partir des VIeVIIe siècles) répond à la nécessité de convaincre le fidèle de la transcendance : à cet effet la figure humaine est privée de volume et sinscrit, dématérialisée en quelque sorte, dans un espace linéaire. Le personnage est nécessairement de face et statique. Le fond doré renforce limpression de gloire et de sacré. La Vierge Marie (proclamée Mère de Dieu au concile dEphèse en 431) est souvent une figure centrale de majesté. Malgré la querelle iconoclaste (711-843), les Byzantins conservent les images en élaborant à leur sujet une réflexion théologique. Elles sont désormais stables dans une représentation dont le sens religieux est fixé avec précision. Le mystère de lIncarnation, les scènes bibliques, les représentations de la Vierge, la Crucifixion, le Jugement dernier, sont présentés à lédification des fidèles. La Bible, mais aussi les évangiles apocryphes, sont sollicités pour fournir les thèmes. Les styles évoluent au cours des siècles, en maintenant les principes généraux de la stylisation.
Si architecture et peinture sont les lieux essentiels de lexpression artistique byzantine, il ne faut pas pour autant négliger les arts mineurs : travail de livoire, objets liturgiques en métaux précieux, manuscrits décorés, tissus historiés à la conservation aléatoire. Un art riche, qui a profondément marqué cet Occident à la limite de lOrient sur plusieurs siècles, art qui impressionne encore aujourdhui, mais que lon a souvent du mal à lire faute de clés culturelles. Ce mince ouvrage (70 pages) en donne quelques-unes, et invite à aller plus loin. Un pari éditorial réussi, et un très bon rapport qualité prix.
Marie-Paule Caire
( Mis en ligne le 06/07/2007 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:Lire à Byzance
de Guglielmo Cavallo Irène de Byzance
de Dominique Barbe | | |