|
|
| Histoire & Sciences sociales -> Période Moderne |
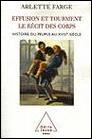 | |
Joies et peines du corps au XVIIIe siècle | | | Arlette Farge Effusion et tourment, le récit des corps - Histoire du peuple au XVIIIe siècle
Complexe - Histoire 2007 / 23.50 € - 153.93 ffr. / 248 pages
ISBN : 978-2-7381-1925-4
FORMAT : 14,5cm x 22,0cm
Imprimer
Les documents utilisés ici sont des archives judiciaires (plaintes et interrogatoires), des rapports de police, des mémoires et chroniques, des lettres intimes aussi. Ils disent le quotidien et lévénement, le banal et le spectaculaire. Tout un XVIIIe siècle occupé à autre chose quà préparer la Révolution. Le souci dArlette Farge nest pas de peindre le tableau du quotidien. Son attention se porte sur les corps en mouvement, au travail ou à la fête, caressés ou flétris, abandonnés ou en promenades publiques. Son intention est de «mettre en scène limportante gestuelle et sensorielle dune société vivant entre tourments et effusions, opposant son corps et sa parole aux pouvoirs et aux événements». Par cette écriture subtile et délicate à laquelle elle nous a habitué, Arlette Farge nous donne peu à peu accès aux sons et aux odeurs, aux gestes réglés des artisans ou aux transports débridés des amoureux. Tous témoignant de la richesse du monde des plus humbles.
Mais sintéresser au peuple ce nest pas lentement et progressivement renouer avec limage du corps du pauvre comme lieu de la nécessité et des besoins les plus immédiats. Tout au contraire, Arlette Farge entend restituer «au corps son infinie noblesse, sa capacité rationnelle et passionnelle à créer avec lhistoire et malgré elle [parce quil est] siège des sensations, des sentiments et des perceptions ». Aussi, lattention portée au peuple ne se justifie pas simplement par le fait quil est la multitude, le plus grand nombre. Elle permet de comprendre non seulement certaines inégalités et séparations, mais surtout certaines incompréhensions et même refus de reconnaissance. Ainsi, dans ce siècle marqué par le libertinage, ce «siècle de léloquence des corps», laristocratie et le pouvoir peinent à reconnaître dans et pour le peuple, et encore moins à autoriser, des pratiques par bien des égard comparables aux jeux voluptueux des salons.
Car le cadre ici est tout autre. La rue, les chemins et places publiques sont le théâtre des sens. De louïe dabord. Car le peuple du XVIIIe siècle, surtout des villes et des faubourgs, baigne dans «une marmite de sons» quasi permanente. Les prix et les arrivages des denrées sont régulièrement annoncés à tous ; et tout le monde y est attentif. Au point quun mémorialiste a pu écrire que «les servantes ont loreille beaucoup plus exercée que lacadémicien». La parole est omniprésente car comme le rappelle Arlette Farge «penser le Siècle des lumières comme étant celui des philosophes exige de ne pas oublier quavant tout, la société est orale». Cette parole populaire, lauteur lexhume de registres dinterrogatoire de police ou de traces de lactivité des écrivains publics : lécrivain public qui «couche loral sur le papier». Une parole diffuse, multiple et permanente qui charrie toutes les émotions. De sorte que bruits, paroles et voix constituent lessentiel de cet univers sonore. Les bavardages et musiques des fêtes et des cérémonies, les annonces officielles criées dans les rues environnent lactivité de chacun.
Lhabitation, cest le quartier. Lieu par excellence de vie et de reconnaissance, de sociabilité et de promiscuité, de la bonne ou mauvaise réputation, où les rixes et agressions éclatent régulièrement et persuadent les philosophes de la vérité de la «nature populaire». Les corps mendiant leur propre survie y sont arrêtés ; parfois avec quelques réactions de solidarité. Mais cest aussi les joies du corps qui se manifestent dans les jeux et les voluptés. Comme le souligne lauteur, «la grande affaire du XVIIIe siècle cest lamour». Mais bien entendu, les salons et les alcôves de laristocratie ne sont pas accessibles à tous. Dautres lieux, dautres gestes sinventent alors. Et «du badinage à lindécence, il est des chemins risqués et condamnables». La promiscuité des corps et la spontanéité des désirs peuvent même parfois encourager le désordre des familles. Linégalité hommes/femmes et les violences subies par elles ne sont pas absentes. Mais il ne faudrait pas déduire de la fréquence (relative) de ces méfaits, quaucune réprobation ne se manifeste : «le corps féminin maltraité ne laisse personne indifférent». De même, lomniprésence de la mort ninsensibilise pas les personnes. Sa violence frappe et provoque du chagrin. Dautres corps constituent et animent cette vie simple et bouillonnante. Des corps abandonnés, comme ces enfants (souvent nouveaux nés) recueillis dans des institutions comme lHôpital des Enfants trouvés à Paris. Des corps flétris et marqués par la justice. Enfin, des corps traversés par de nouvelles pratiques médicales comme linoculation.
Louvrage dArlette Farge ne correspond donc pas seulement à une contribution aux nombreuses publications actuelles sur ce thème. Elle signale que si les historiens du XVIIIe siècle ont beaucoup étudié les conditions de vie de la population y compris des plus pauvres et des plus humbles, il semble que le corps ait peu été étudié et encore moins présenté comme un des «lieux du politique et de lhistoire». Cest à présent chose faite.
Pierre-Olivier Guillet
( Mis en ligne le 11/05/2007 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:Quel bruit ferons-nous ?
de Arlette Farge Entretien avec Arlette Farge | | |
|
|
|
|
|