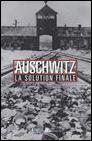 | |
Histoire et mémoire d'un génocide | | | Annette Wieviorka Collectif Auschwitz - La Solution finale
Tallandier 2005 / 21 € - 137.55 ffr. / 304 pages
ISBN : 2-84734-211-7
FORMAT : 15x22 cm
L'auteur du compte rendu : Agrégé dhistoire et titulaire dun DESS détudes stratégiques (Paris XIII), Antoine Picardat est professeur en lycée et maître de conférences à lInstitut dEtudes Politiques de Paris. Ancien chargé de cours à lInstitut catholique de Paris, à luniversité de Marne la Vallée et ATER en histoire à lIEP de Lille, il a également été analyste de politique internationale au ministère de la Défense.
Imprimer
Comme toutes les commémorations, celle, il y a trois mois, du 60e anniversaire de la découverte et de la libération par lArmée rouge des camps dAuschwitz a été loccasion dune abondante production éditoriale, constituée pour lessentiel de deux groupes. Dune part les recueils de témoignages et autres souvenirs de survivants, qui sont désormais devenus un genre à part entière en histoire, dautre part des ouvrages généraux sur la Shoah.
Dans lensemble, ces derniers nont rien apporté de nouveau à la connaissance ou à la tentative de compréhension, ne serait-ce que technique, de celle-ci. En revanche, ils proposent souvent dintéressantes synthèses ou des mises à jour des connaissances sur la question. Auschwitz. La solution finale appartient à cette deuxième catégorie douvrages. Il rassemble 24 articles, tous parus dans la revue LHistoire, dont on retrouve beaucoup de signatures habituelles, et organisés en trois parties : «Les mécanismes de lextermination», «Spectateurs, résistants et complices» et «Histoire et mémoire du génocide». Sajoutent à cela un plan du complexe dAuschwitz-Birkenau, une chronologie et un lexique des termes de la Shoah.
La plupart des articles portent sur des sujets classiques et sont plutôt descriptifs : sur les origines et les étapes de la Solution finale, le fonctionnement du camp dAuschwitz, les silences du Vatican ou linsurrection du ghetto de Varsovie. Lun de ces articles mérite dêtre spécialement mentionné : «Enquête sur les chambres à gaz» de Jean-Claude Pressac. Lauteur, décédé en 2003, présente la particularité davoir commencé sa carrière en flirtant avec les milieux négationnistes. Mais les recherches quil mena dans les archives conservées à Auschwitz le convainquirent bien vite de latroce et incontestable vérité des chambres à gaz et du système dextermination. Il devint alors un spécialiste de la dimension technique de cette extermination. Son article, outre lintérêt de litinéraire de Jean-Claude Pressac, est à la fois passionnant et terrifiant, en ce quil expose la froide technicité, à la fois bureaucratique et industrielle, des problèmes que rencontrèrent et résolurent aux différentes étapes du processus, les artisans de la Shoah, chacun à son niveau de responsabilités. Tous ces articles, même sils font un peu catalogue, fournissent donc des mises au point ou des récits bien utiles en particulier pour ces éternels chercheurs dinformations que sont les enseignants ou les étudiants.
Le grand intérêt de louvrage réside peut-être dans un petit nombre de textes, qui posent des problèmes allant au delà de la connaissance, mais qui, finalement, y renvoient. «Faut-il des lois contre les négationnistes ?», interroge, sceptique, Madeleine Rebérioux. La question se pose en effet, au moment où la tendance à légiférer sur tout, notamment sur ce qui relève de la recherche et du débat entre historiens, se confirme. Dautant que lefficacité de telles lois est rien moins quévidente. Jamais une loi ne remplacera en effet la connaissance, laquelle peut seule fonder légitimement un interdit. Ensuite, un entretien avec Dominique Borne, doyen de lInspection-générale dhistoire-géographie, pose la question de «Comment parler dAuschwitz à lécole ?» et le problème de la mémoire. Hasard ? En tout cas ce soixantième anniversaire a été marqué par des références systématiques mais très confuses à la mémoire et au «devoir de mémoire», mais aussi par la découverte que des lycéens pouvaient mal se comporter lors dun voyage scolaire à Auschwitz...
Hasard heureux en tout cas, car, comme le dit Dominique Borne, et comme la rappelé Annette Wieviorka récemment, la mémoire ne doit pas être le résultat dune injonction. Elle ne peut exister sans connaissance, donc sans un travail de découverte et dappropriation. On sent bien ici les ambiguïtés, voire les dangers, dun «devoir de mémoire» érigé au rang de dogme, qui lemporte trop souvent sur la connaissance de fond. Ce «devoir» risque dêtre peu productif, ou pire, sil est assené comme un corps de doctrine à accepter tel quel, sans que son sens, sans que les faits et les processus à lorigine de ce dont il entend conserver éternellement le souvenir, soient suffisamment expliqués.
Antoine Picardat
( Mis en ligne le 27/04/2005 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:La Persécution des tsiganes par les nazis
de Guenter Lewy L'Expérience concentrationnaire est-elle indicible ?
de Luba Jurgenson Auschwitz, l’album, la mémoire
de Alain Jaubert | | |