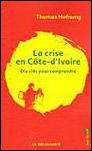 | |
France, Afrique et post-colonialisme | | | Thomas Hofnung La Crise en Côte-d'Ivoire - Dix clés pour comprendre
La Découverte - Sur le vif 2005 / 8 € - 52.4 ffr. / 140 pages
ISBN : 2-7071-4708-7
FORMAT : 12,0cm x 19,0cm
L'auteur du compte rendu : Archiviste-paléographe, docteur de l'université de Paris-I-Sorbonne, Thierry Sarmant est conservateur en chef du patrimoine au Service historique de l'armée de Terre. Il prépare, sous la direction du professeur Daniel Roche, une habilitation à diriger des recherches consacrée à "Louis XIV et ses ministres, 1661-1715". Il a publié une vingtaine d'articles sur l'histoire politique et culturelle de la France moderne et contemporaine et six ouvrages dont Les Demeures du Soleil : Louis XIV, Louvois et la surintendance des Bâtiments du roi (2003)et La Roumanie dans la Grande Guerre et l'effondrement de l'armée russe (1999).
Imprimer
Tandis que le Parlement, dans un beau mouvement de démagogie, vote une loi faisant des bienfaits de la colonisation française une vérité officielle, lanticolonialisme militant connaît une vigoureuse résurgence dans la presse et dans lédition. Traite négrière, travail forcé, torture en Algérie, essais nucléaires dans le Pacifique, il nest pas de semaine où le filon du «péché colonial» ne soit abondamment exploité. Cest que la colonisation est bonne fille, qui explique à la fois le sous-développement économique et les convulsions politiques du Tiers-Monde, limmigration massive vers lEurope et les ratés de lintégration.
Dans cette veine, il est tentant dimputer aux méfaits du colonialisme, du néo-colonialisme, voire dun «post-colonialisme», la crise où senfonce la Côte dIvoire depuis 1999. La chronique précise et nuancée de Thomas Hofnung apporte cependant à ce schéma de précieuses corrections. Les origines coloniales de laffaire sont indéniables : comme la plupart des pays dAfrique noire, la Côte-dIvoire est un agrégat dethnies, une création artificielle du colonisateur, une division administrative transformée en Etat. Elle devient indépendante en 1960, par la seule volonté dune France pressée de liquider un Empire devenu obsolète.
Cest alors que souvre lâge dor du néo-colonialisme français, période qui, en Côte-divoire, correspond au long règne de Félix Houphouët-Boigny, de 1960 à 1993. Prospérité sans véritable développement, fondée sur lexportation du cacao, équivalent ivoirien du pétrole, autocratie dHouphouët, père de la nation et monarque absolu, qui étouffe toute contestation et décourage toute évolution, alignement indéfectible sur la France, qui dispense à Abdijan ses fonctionnaires et y stationne ses soldats, tels sont les principaux caractères de ces trois décennies. La jeune nation est le joyau de la «Françafrique» et les ressortissants des pays voisins y affluent pour bénéficier des bienfaits du miracle ivoirien.
Avec la chute des cours du cacao, la fin de la guerre froide, puis la mort dHouphouët, la Côte-dIvoire entre dans sa troisième époque, quon peut appeler «post-coloniale», celle où elle est encore. La prospérité se défait et lidentité nationale, en quête dune hypothétique «ivoirité», se délite. À la fin du XXe siècle, le pays senfonce dans le désordre : coup dEtat qui dépose Henri Konan Bédié en 1999, élection de Laurent Gbagbo en 2000, rébellion du Nord en 2002, accords avortés de Marcoussis en 2003, offensive ratée du régime dAbidjan contre le Nord en 2004, massacre de Douékoué en 2005. Pour la France, laffaire tourne au désastre. Au cours des émeutes de 2003 et 2004, les Blancs de Côte-dIvoire sont molestés et leurs biens pillés ; la majorité dentre eux quitte le pays, sans doute pour toujours ; neuf soldats français trouvent la mort le 6 novembre 2004 dans le bombardement de la base de Bouaké. Soucieux de rompre avec les compromissions de la génération politique précédente, le gouvernement français a refusé de prendre parti dans les querelles intestines du pays, a tenté de favoriser le pluralisme et la réconciliation nationale. Léchec est total. Pouvait-on faire mieux ? Rien nest moins sûr.
Après une telle déconfiture, la puissance ci-devant coloniale pourrait rechercher, par politique ou par dépit, le désengagement. Mais ce retour au cartiérisme doctrine ayant pour principe «la Corrèze avant le Zambèze» ne paraît ni souhaitable ni vraiment possible. Th. Hofnung a beau jeu de souligner que les Ivoiriens les plus francophobes vivent à lheure de lancienne Métropole, que la nomenklatura dAbidjan y envoie ses enfants, y achète maisons et appartements. Du côté français, la rupture paraît aussi peu plausible : avec 60 000 Ivoiriens et plusieurs centaines de milliers de ressortissants de lAfrique de lOuest résidant en France, comment se désintéresser du sort de lex-«A.O.F.» ? En lan 2000, Abidjan est plus proche de Paris que Rennes ou Perpignan ne létaient en 1950. Et limplosion de lAfrique francophone, ce serait lassurance de la montée vers lEurope de dizaines voire de centaines de milliers de candidats-migrants
Une chose est sûre, les clefs du drame ivoirien ne sont plus en France. De nouveaux acteurs, fort peu désintéressés, entrent en scène, Américains, Chinois, Nigérians, Sud-Africains. Surtout, le nud du drame se joue au sein des élites ivoiriennes, avides de pouvoir et dargent, indifférentes à lintérêt général. Les observateurs distanciés de ces élites se partagent entre deux écoles. Pour les pessimistes, la crise ivoirienne est un nouvel exemple du processus de décomposition de lEtat, de régression vers la barbarie, qui serait à luvre dans une bonne partie de lAfrique noire. Pour les optimistes, il sagit au contraire dun désordre créateur ; en Côte-dIvoire, comme ailleurs en dautres temps, lEtat-nation se forge dans le mensonge et dans le sang.
Thomas Hofnung se garde de trancher. Il montre seulement quà lère «post-coloniale» la responsabilité de lancienne métropole nest plus seule en cause. Sans simplisme ni pathos, il dépeint lheure présente, faite de pillages et des massacres, du jeu des alliances et des affrontements entre chefs de guerre et politiciens sans conscience. Jeu stérile, tantôt grotesque et tantôt tragique, sans bons ni méchants, et où, à la fin, suivant lheureuse formule de Joseph Staline, «il ny a que la mort qui gagne».
Thierry Sarmant
( Mis en ligne le 09/11/2005 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:Georges Marchais
de Thomas Hofnung | | |