|
|
| Histoire & Sciences sociales -> Sociologie / Economie |
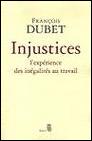 | |
Certains plus égaux que d'autres... | | | François Dubet Collectif Injustices - L'expérience des inégalités au travail
Seuil 2006 / 23 € - 150.65 ffr. / 490 pages
ISBN : 2-02-086378-2
FORMAT : 14,5cm x 22,0cm
L'auteur du compte rendu: titulaire dune maîtrise de Psychologie Sociale (Paris X-Nanterre), Mathilde Rembert est conseillère dOrientation-Psychologue de lEducation Nationale.
Imprimer
Passant à la caisse dun supermarché, un client ne prend pas la peine dinterrompre sa conversation au portable pour saluer la caissière qui enregistre ses achats. Un fonctionnaire qui estime travailler plus que ses collègues se plaint de recevoir la même notation que les autres. Des aides-soignantes, situées en bas de la hiérarchie hospitalière, se sentent complètement invisibles alors quelles estiment faire un travail indispensable auprès des malades. Toutes ces situations engendrent des sentiments dinjustice. Cest à ce thème que se sont intéressés les sociologues Valérie Caillet, Régis Cortéso, David Mélo et Françoise Rault, sous légide de François Dubet.
De 2003 à 2005, ces chercheurs ont mené une enquête denvergure auprès de groupes professionnels variés, allant des cadres aux chauffeurs de taxi en passant par les chefs de rayon et les couturières. En plus des 300 entretiens individuels et collectifs effectués, un questionnaire a été adressé à plus de 1000 personnes. La question de linjustice occupe une place importante dans luvre de Dubet, qui a notamment travaillé sur lécole et la jeunesse. Il a notamment écrit avec Marie Duru-Bellat LHypocrisie scolaire (Seuil, 2000) et a publié récemment LEcole des chances (Seuil, 2004). Injustices aborde le monde du travail et non celui de léducation, mais on y retrouve la même réflexion sur les principes de justice que dans le dernier opus de Duru-Bellat, LInflation scolaire.
Les auteurs commencent par exposer les principes fondamentaux de justice : légalité, le mérite et lautonomie. Lexistence de «castes» et les discriminations racistes seront par exemple combattues au nom du principe dégalité. Si lon se réfère plutôt au mérite, on critiquera le piston mais on trouvera normal que les postes à responsabilités soient réservés aux plus diplômés. Quant aux tenants du principe dautonomie, ils accordent de limportance au fait daimer son travail et de réaliser sa vocation. Ces trois principes de justice sarticulent concrètement dans le domaine du droit (par exemple aux prudhommes), dans celui du pouvoir (on peut aussi bien se plaindre dun pouvoir hiérarchique trop fort que dun pouvoir trop faible), et dans celui de la reconnaissance (les auteurs donnent lexemple des enseignants qui subiraient actuellement une perte de reconnaissance). Les trois principes de justice étant forts différents les uns des autres, la critique ne sarrête jamais. On peut toujours contester un principe à partir dun autre. Légalité contre légoïsme
Le mérite contre le favoritisme
Lautonomie contre légalitarisme
Et ainsi de suite.
Les sentiments dinjustice sont liés à la position sociale, On peut croire que les inégalités sont dautant plus justifiées que lon monte dans léchelle sociale. Cest en partie vrai mais les sociologues montrent que la réalité est plus nuancée. On ne peut pas dire que le mérite soit uniquement une valeur des classes dominantes. Cependant, il est vrai que les gens de droite sont plus attachés au mérite et les gens de gauche, plus à légalité. Les auteurs présentent alors divers types dorganisation du travail fondés sur tel ou tel principe de justice. Ainsi, le taylorisme est basé sur le mérite et légalité mais les individus y manquent dautonomie. Le «nouveau management», qui implique de la liberté, saccorde bien avec le mérite et avec lautonomie, mais légalité y est laissée en berne. La bureaucratie professionnelle, elle, valorise, légalité et lautonomie mais dévalorise le mérite.
Est alors abordée la question du sentiment dinjustice dans différentes catégories professionnelles. Les auteurs distinguent les «invisibles» (chargées de cours à luniversité, aides-soignantes), les «exploités» (ouvriers du bâtiment, caissières), les «mis à lépreuve» (chefs de rayon, cadres débutants) et les «indépendants sous contrainte» (agriculteurs, intermittents du spectacle). Lavant-dernier chapitre montre quil existe une distance entre le sentiment dinjustice et laction. Ainsi, une personne peut avoir un sentiment dinjustice mais se montrer fataliste : «de toute façon, on ne peut rien y changer». Certains adhérent sans sen rendre compte à la croyance selon laquelle les victimes dinjustice sont coupables de leur sort (notamment les «classes dangereuses»). Enfin, les auteurs explorent lexpérience individuelle des injustices : les sentiments comme la honte, la culpabilité ou la peur, et la manière dont les gens leur résistent, par exemple, par le détachement, ou par le militantisme. On quitte donc la question de juste pour aborder celle du Bien et de sa recherche par les individus.
Jamais Dubet et ses pairs ne se mettent en «position haute» par rapport à leurs enquêtés. En sintéressant au sort des jeunes chercheurs précaires de luniversité, ils montrent bien que le sociologue ne saurait être au-dessus de son objet détude. Ce positionnement apporte de lhonnêteté à cet ouvrage riche denseignements pour qui sintéresse au monde actuel du travail.
Mathilde Rembert
( Mis en ligne le 21/06/2006 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:L'Inflation scolaire
de Marie Duru-Bellat L'Usine à vingt ans
de Naïri Nahapétian Le Capital social
de Michel Lallement , Antoine Bevort , Collectif | | |
|
|
|
|
|