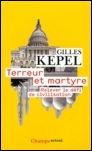 | |
La poudrière et les étincelles | | | Gilles Kepel Terreur et martyre - Relever le défi de civilisation
Flammarion - Champs 2009 / 9 € - 58.95 ffr. / 366 pages
ISBN : 978-2-08-122295-3
FORMAT : 11,0cm x 18,0cm
L'auteur du compte rendu: Gilles Ferragu est maître de conférences en histoire contemporaine à luniversité Paris X Nanterre et à lIEP de Paris.
Imprimer
Problème de géographie appliquée : comment faire tenir, dans une même région, plusieurs divinités (et leurs fidèles, prosélytes ou pas), quelques régimes aux idéologies adverses, plusieurs haines recuites, du pétrole (beaucoup), des idées (trop ?) et autant de racines communes ? Le Moyen Orient serait-il trop petit ? Serait-il la transposition contemporaine de la célèbre «poudrière balkanique» ? Et plus basiquement, Israéliens, Palestiniens, Irakiens, Iraniens, Libanais, Syriens
ont-ils un avenir commun ailleurs que dans lau-delà ? Cest à cette équation complexe et irrésolue que Gilles Kepel, grand spécialiste de lIslam politique et professeur à lIEP de Paris, sattaque dans une synthèse aussi efficace que lumineuse.
Terreur et martyre démarre sur un constat : celui de laffrontement patent, depuis le 11 septembre 2001, non pas de deux civilisations (selon les proses néoconservatrice et islamiste, pour une fois en accord), mais plutôt de deux grands mythes politiques, deux «Grands récits» fondateurs. Dun côté, le grand récit américain, celui dune guerre entre le Bien et le Mal, entre les démocraties libérales et la «Terreur»
incarnée par les mouvements terroristes, quelques États voyous et autres docteurs Folamours. De lautre côté, le grand récit musulman du martyre, récit plus compliqué à mettre en uvre, aux visées panarabes et anti-occidentales, mais tiraillé entre des idéologies et des religions parfois adverses.
A priori, un affrontement simple, voire simpliste, manichéen, où ladversaire est relativement facile à identifier. Mais Gilles Kepel montre combien le camp du bien, quel quil soit, est difficile à incarner, tant laffrontement suppose de compromissions éthiques et autres dégâts collatéraux. Passant de Guantanamo à Abou Ghraïb, il explore déjà les aspects troubles de la gestion de la victoire, côté américain : une victoire militaire qui débouche sur une paix armée, mal gérée, calamiteuse. En rejouant la victoire de 1945 et la dénazification, le gouvernement américain a raté le coche de la pacification. La guerre, puis la victoire, sont devenues des bourbiers
et dautant plus risqués que laffaire irakienne sétend à toute la région. Cest lIran - dont la politique, depuis la révolution de 1979, toute daffirmation de puissance, de tensions internes entre réformateurs et traditionnalistes, de flirts avec lextrêmisme et de marginalité assumée au nom du bon droit nucléaire - qui bouscule les lignes irakiennes et y avance ses pions. Un impérialisme religieux répondant à limpérialisme politique des néoconservateurs. Cest lIrak, déchiré entre ses communautés religieuses et ethniques, qui nexiste plus, comme nation, que dans les reportages occidentaux. Cest le conflit israélo-palestinien, qui prospère, et qui mute par réflexe, en fonction denjeux régionaux. Dans une première partie, lauteur dresse le tableau du «fiasco» irakien, de ses principaux acteurs, de ses moments forts, avec, au final, un bilan catastrophique.
Mais en spécialiste de lislam, G. Kepel sintéresse, dans une seconde partie, surtout aux mutations induites par les conflits (américano-irakien et israélo-palestinien) : une mutation qui touche lislam et le conflit sunnite / chiite (via la fitna, la «discorde» qui sest réveillée avec cette crise orientale), et en particulier, au sein du débat théologique, la question, déjà épineuse, du jihad et du terrorisme. Car lune des conséquences importantes de ces conflits est la contamination du chiisme au sunnisme de lesprit du martyre. Seul adversaire viable pour Israël, le Hezbollah libanais, épaulé par lIran, figure un modèle qui gagne la rue arabe, celui dune stratégie coûteuse, fondée sur le martyre, mais efficace. Et lauteur de montrer comment progressivement, via Al Qaida, le martyre terroriste sest doté dune justification religieuse, théologique, certes débattue (du fait de linterdit du suicide), mais qui finit par avoir gain de cause. Et comment la méthode des bombes humaines, jusque-là cantonnée au terrorisme chiite, gagne la communauté sunnite ; Avec ce que cela peut impliquer en terme de terrorisme.
Une évolution à laquelle font écho les troisième et quatrième parties, consacrées à la troisième génération du jihad, qui revendique lhéritage irakien. Après la geste afghane des années 1980 (contre linvasion soviétique), cadre dun premier jihad, après le 11 septembre 2001 et ses imprécations contre les «sino-croisés» - deuxième jihad -, une troisième phase du jihad se déroule maintenant, entre lIrak, lAfghanistan, la Palestine, le Liban
une phase extensive où lennemi désigné au choix, loccident, le sionisme, le progrès, la modernité fait lobjet dune sorte de surenchère entre courants islamistes. Les mouvements terroristes usent largement des outils de la modernité, en particulier des médias, et, à coup dattentats et de victimes, revendiquent dincarner seuls le front du jihad. G. Kepel nous introduit ainsi dans les coulisses dAl Qaida, aux côtés dAl Zawahiri, lancé dans une course à laudimat islamiste via Al Jazeera et linternet. Passant dune crise à lautre (le Londonistan et sa fin, les caricatures danoises, lassassinat de Théo Van Gogh
), lauteur, très pédagogiquement, relit lactualité récente à la lumière de ce conflit interne à lislamisme et éclaire les enjeux religieux de la crise actuelle et, plus largement, de la fitna. Une autre lecture de lactualité, très cohérente, celle du regard islamiste et qui fait largement pièce au grand récit américain.
Louvrage se signale donc au lecteur attentif de lactualité : par son sens de la pédagogie, par son approche à la fois synthétique et exigeante des diverses questions, par son ambition déclairer un débat complexe au sein de lislamisme, un débat qui échappe très largement aux médias occidentaux. Si bien évidemment, on peut regretter que certaines questions (lAfghanistan, le Pakistan
) ne soient pas plus détaillées, il faut se rappeler quil sagit là dun essai explicatif qui privilégie lexposé solide dune théorie au tableau composite dune idéologie. Un essai réussi, passionnant, inquiétant.
Gilles Ferragu
( Mis en ligne le 10/03/2009 )
Imprimer
A lire également sur parutions.com:Jihad
de Gilles Kepel | | |